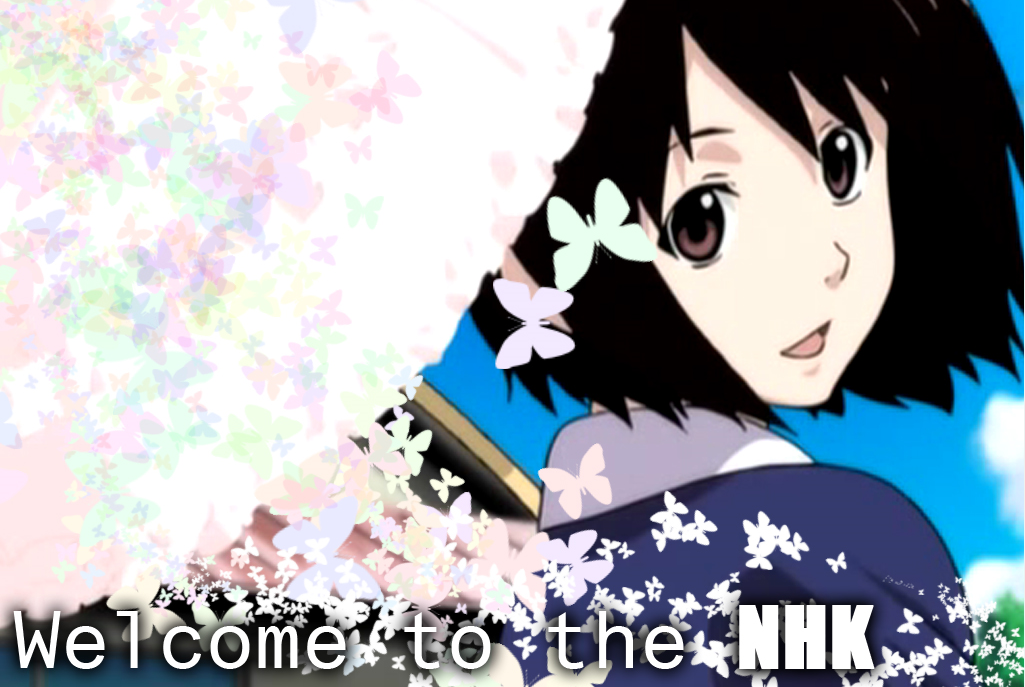
Nhk, une télévision au service du peuple?
- Select a language for the TTS:
- French Female
- French Male
- French Canadian Female
- French Canadian Male
- Language selected: (auto detect) - FR
Play all audios:

UN SERVICE PUBLIC SUR LE MODÈLE DE LA BBC La NHK (abréviation de Nippon Hôsô Kyôkai, soit Japan Broadcasting Corporation en anglais) est le plus grand groupe audiovisuel japonais. C’est
aussi par son chiffre d’affaires – près de 6 milliards d’euros en 20101 la première société de télévision au monde. Le groupe NHK se confond souvent avec sa chaîne principale, la NHK
généraliste (Sôgô Terebijon) diffusant principalement des informations – le journal de sept heures est celui le plus regardé par les Japonais - ainsi que des émissions culturelles et
éducatives. Il existe également une deuxième chaîne terrestre, la NHK éducative (Kyôiku Terebijon), ainsi que deux chaînes sur satellite, NHK BS1 et NHK BS Premium. En 2009, elle a également
lancé sa chaîne internationale, NHK World TV. Enfin, car c’est là l’origine de ce groupe médiatique, la NHK possède deux radios AM, Radio 1 et Radio 2, une radio FM et une radio
internationale, NHK World - Radio Japan. La NHK a pour mascotte Domo-kun, une petite créature marron issue d'un oeuf (logo de la NHK). Il apparaît à la télévision dans des clips
d'animation image par image (_stop motion_) au côté du vieux lapin Usajii. Avant de se consacrer principalement à la télévision, la NHK fut d’abord une radio créée en 1926 sur le modèle
de la BBC, par le regroupement des radios Tokyo, Osaka et Nagoya2. Il s’agissait alors d’une société privée, placée sous le contrôle de l’État en vertu de l’article 1 de la loi sur le
télégraphe de 19153>. Avec la montée du militarisme, la radio devint progressivement l’organe de propagande du gouvernement : à partir de 1941, le jazz fut banni des ondes, les programmes
d’enseignements de l’anglais, du français ou du chinois supprimés et le très zélé ministère des Postes et Télécommunications (Sômushô) alla même jusqu’à demander aux présentateurs de ne
plus utiliser de mots provenant de l’anglais4. Avec l’occupation et la démocratisation du Japon, un nouveau groupe NHK est créé dans le cadre des « trois lois sur la radio » de 1950. Parmi
ces trois lois, celle sur l’audiovisuel (Hôsôhô) fixe un cahier des charges très strict pour la NHK, mais aussi pour les stations commerciales qui sont alors autorisées à émettre.
Aujourd’hui, on parle des « Big Five », les cinq principales chaînes commerciales de l’Archipel que sont NTV, TBS, Fuji Television, TV Asahi et TV Tokyo, toutes liées aux cinq principaux
groupes de presse5. Toutes doivent respecter quatre principes : * ne pas troubler l’ordre public et les bonnes mœurs, * être politiquement neutre, * diffuser des informations qui n’ont pas
été déformées, * lors de controverse, clarifier les enjeux en abordant la question par différents angles. De plus, toutes les chaînes sont tenues de respecter un équilibre entre émissions
culturelles, de divertissement et informations. Dans la pratique, en raison d’une concurrence extrême pour l’obtention de sponsors et de spots de publicité, les chaînes privées ont eu
tendance à privilégier le divertissement. Ces règles s’appliquent donc surtout à la NHK qui se voit interdite, par la loi sur l’audiovisuel, de rechercher le profit (article 9-9) ou de
diffuser de la publicité6. De plus, la loi donne au groupe audiovisuel public des missions particulières. La NHK a pour première tâche de favoriser la démocratisation et d’éduquer le peuple
avec des émissions de qualité. Elle doit également être en permanence à l’écoute des attentes du public et de ses critiques. Pour cela, la NHK réalise de nombreux sondages d’opinion et
dispose d’un très important centre d’appels où les téléspectateurs peuvent exposer leurs griefs. Mais la chaîne va plus loin en allant régulièrement à la rencontre de son public. En 2009 par
exemple, la NHK avait organisé partout au Japon plus de 2000 « réunions de téléspectateurs », rassemblant 53 000 personnes7. C’est par ce rapport très étroit qu’un respect mutuel s’était
installé entre la NHK et ses usagers, avant que des scandales politico-financiers conduisent à une détérioration de l’image de la chaîne. La NHK doit par ailleurs améliorer et étendre la
radiodiffusion sur le territoire, ce qui est largement acquis aujourd’hui. Comme nous le verrons plus loin, elle doit également mener des recherches scientifiques sur l’audiovisuel, dans le
but de faire du Japon un pays à l’avant-garde dans ce domaine. Elle dispose pour cela d’un laboratoire de recherche scientifique et technique créé en 1930. Enfin, la NHK doit être la vitrine
du Japon à l’international, par le biais de NHK World TV et Radio Japan8. Bien qu'indépendante, la NHK est étroitement encadrée juridiquement et aussi liée à l’État. UNE INDÉPENDANCE
FINANCIÈRE RÉELLE La NHK est une société de service public d’un type particulier puisque ses revenus proviennent quasi-exclusivement des redevances payées par les téléspectateurs. Cette
règle est fixée par la loi sur l’audiovisuel qui dispose que chaque foyer achetant une télévision doit signer un contrat avec la NHK pour payer une redevance. Cette redevance obligatoire est
payée directement à la NHK, sans intervention de l’État. En 2010, la redevance annuelle pour les chaînes terrestres était de 14 910 yens (soit 130 euros) et celle pour l’ensemble des
chaînes du groupe de 25 520 yens (soit 223 euros)9. Cette loi ne prévoit cependant aucune pénalité en cas de non-paiement et environ 30 % des téléspectateurs japonais ne verseraient pas la
redevance10. Pour inciter les usagers à payer, le groupe envoie régulièrement des employés faire du porte-à-porte pour rappeler que le règlement de la redevance est obligatoire. La collecte
de la redevance est d’ailleurs le deuxième poste budgétaire de la chaîne (10 % du budget en 2010), derrière la production et la retransmission d’émissions (71 %)11. Le chiffre d’affaires de
la NHK était en 2010 de 678,6 milliards de yens, soit près de 6 milliards d’euros12, 13>14. Ces revenus proviennent à 96,5 % de la redevance, complétés par la vente de DVD,
d'émissions et documentaires de la NHK et de financements divers11. L’indépendance financière de la NHK est donc une réalité et un certain nombre d’auteurs ont conclu un peu vite que
son indépendance vis-à-vis du pouvoir étatique était également acquise. Source _Broacasting in Japan_, Éditions NHK UNE PROXIMITÉ DU POUVOIR PROBLÉMATIQUE En réalité, cette indépendance
financière ne prémunit pas la chaîne publique japonaise d’une certaine proximité avec le pouvoir. La direction de la NHK est composée de 12 membres tous nommés par le Premier ministre, avec
l’accord des deux chambres de la Diète. Ces derniers élisent parmi eux le directeur-général de la NHK15. De plus, le budget annuel de la NHK est transmis au ministère des Communications, au
cabinet du Premier ministre puis est discuté à la Diète et voté par les deux chambres16. Si l’administration n’intervient pas directement dans les décisions concernant la grille des
programmes, elle peut influencer les membres de la direction assis sur de véritables sièges éjectables renouvelables tous les trois ans17. Et ce d’autant plus dans un pays où le Parti
libéral démocrate a été au pouvoir de manière hégémonique de 1955 à 2009. Ainsi, dans des situations critiques le retour du contrôle étatique peut être brutal, pour le meilleur comme pour le
pire. Le meilleur, à l’instar du séisme du 11 mars 2011, où la chaîne de télévision devient un diffuseur d’alertes, d’informations météorologiques diverses en vertu d’accords et
d’obligations fixées par la loi18. L’Agence météorologique japonaise est par exemple tenue de transmettre à la NHK en temps réel les informations dont elle dispose lors d’alerte au tsunami.
Pour informer la population rapidement en cas de désastre naturel, la NHK dispose de 14 hélicoptères et de 460 caméras répartis dans des zones urbaines sur tout le territoire nippon19. Mais
parfois le contrôle étatique est moins vertueux. En septembre 1946, des employés de la NHK apportent leur soutien à la grève du journal Yomiuri et réclament une hausse des salaires. Après
des négociations qui échouent avec la direction, la grève commence le 5 octobre. C’est le black-out total, silence radio sur les ondes de la première station du pays. La réaction du
gouvernement ne se fait pas attendre. Au bout de trois jours, la police s’empare du bâtiment de la NHK et monte la garde de jour comme de nuit. Les fonctionnaires du ministère des Postes et
Télécommunications rédigent et diffusent six fois par jour des « informations ». Pendant vingt jours, la radio devient le porte-voix du gouvernement. Cet incident de parcours révèle les
liens étroits unissant les groupes médiatiques et le ministère des Postes et Télécommunications – devenu depuis 2001 le ministère des Affaires intérieures et des Communications. Le
ministère, en plus de surveiller étroitement le budget annuel de la NHK, délivre des autorisations d’émettre pour les médias privés, renouvelables tous les cinq ans. Ce qui n’encourage guère
les « Big Five » et les principaux journaux qui en dépendent à être critiques vis-à-vis du gouvernement. De plus, le ministère des Communications n’échappe pas à la pratique de
l’_Amakudari_20 qui consiste pour un haut fonctionnaire du ministère à rejoindre le conseil d’administration d’un groupe médiatique à la fin de sa carrière21. UNE IMAGE ÉCORNÉE PAR LA
CORRUPTION ET LA RESTRUCTURATION Dans les années 2000, la NHK a connu plusieurs crises majeures qui ont détérioré son image auprès des usagers. En 2005, il fut révélé que la NHK avait
censuré, dans un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale des témoignages d’ex-« femmes de réconfort », ces dizaines de milliers de femmes contraintes par l’armée japonaise à se
prostituer. La NHK avait alors obéi à des pressions venant de politiciens révisionnistes du PLD, proche du Premier ministre de l’époque, Junichirô Koizumi. Pour Keiichi Katsura, professeur
de journalisme à l’université Taishô de Tôkyô, cela constitue la preuve que « la NHK est plus redevable aux hommes politiques du PLD qu’aux usagers »22, 22. S’ajoutant à cela, un autre
scandale de détournement d’argent par la direction a révélé au grand public l’envers d’une chaîne que l’on croyait intègre. En janvier 2005, le président de la NHK, Katsuji Ebisawa, fut
contraint à la démission. Conséquence de ces affaires : une campagne de boycott des redevances entraîna une baisse des revenus du groupe entre 2005 et 2006. Prenant prétexte de cela, et en
conformité avec la « stratégie du choc » décrite par Naomi Klein, la NHK mit en place un vaste plan de restructuration visant à supprimer 10 % de son personnel, soit 1200 emplois. Après
avoir connu un pic de 16 500 employés en 1972, le groupe audiovisuel nippon s’est efforcé depuis de maintenir le nombre d’employés en-dessous des 15 000, puis des 12 000 et ce malgré son
expansion continue23. UNE CHAÎNE À LA POINTE DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE Dans ce contexte de crise relative, de quoi sera fait l’avenir de la NHK ? Sur le plan technique, la NHK reste une
des plus belles réussites dans l’univers de l’audiovisuel, notamment dans le domaine technologique. Depuis 1925, il existe une obsession constante à la NHK d’être à l’avant-garde des
techniques de radio et télédiffusion. Dans un ouvrage fort intéressant du NHL Broadcasting Culture Research Institute – institut créé en 1946 pour conserver la mémoire de la NHK et produire
des études sur l’audiovisuel24 – le groupe ne manque pas l’occasion de rappeler que la radio NHK fut créée seulement 4 ans et 4 mois après la première station de radio au monde. En 1930, le
ministère des Postes et Télécommunications poussa rapidement à la création d’un laboratoire de recherche scientifique qui concentra ses études sur la télévision. Son budget était alors fixé
à 3 milliards de yens en 1937, soit 11,8 % du budget annuel de la NHK25. En 1939, il réalise même le premier test de retransmission télévisée mais les recherches seront abandonnées avec le
début de la guerre du Pacifique en 194126. Dans la période d’après-guerre, la NHK lance sa première chaîne de télévision en 1951, suivi de la chaîne éducative en 1959. Mais le nombre de
foyers équipés en postes de télévision est encore rare, en raison de leur coût élevé. Comme il l’avait fait avec les postes à galènes, le ministère de l’Industrie et du Commerce (Miti)
encourage la production nationale de téléviseurs pour accompagner et soutenir la NHK27. Cette planification ministérielle accompagnée des recherches de la NHK propulse le Japon comme
principal exportateur de postes de télévision dans les années 1970, puis de magnétoscopes à partir des années 1980. L’audience au Japon connaît par ailleurs un bond formidable grâce à deux
évènements : le mariage du prince Akihito – l’actuel empereur – en 1959 et les jeux Olympiques de Tôkyô en 1964. Alors qu’en 1954 il n’y avait qu’à peine 17 000 téléspectateurs devant leur
poste, dix ans plus tard leur nombre passe la barre des 4 millions28. Au début des années 1960, la NHK est de plus une des premières chaînes au monde à diffuser des images couleurs, alors
même que peu d’usagers sont équipés en poste de télévision couleur29. Puis la NHK va initier le lancement de deux chaînes satellitaires et travailler en parallèle, sur la télévision
haute-définition. C’est ainsi que dès 1992, les chaînes BS de la NHK vont commencer à diffuser des programmes en _Hi-Vision_ (terme utilisé au Japon pour la HD) puis qu’une chaine BS-HD va
être créée. La chaîne nippone fut une pionnière dans ce nouveau format vidéo de haute-définition sur laquelle elle travaillait depuis 1964. Ses recherches portent aujourd’hui sur un format
vidéo d’ultra haute-définition pour la télévision - UHDTV, _Super Hi-Vision_ au Japon - capable d’afficher 33,18 millions de pixels, 16 fois plus que le format haute-définition actuel30. Le
groupe prévoit le lancement de ce format en 2025, pour son centième anniversaire31. L’autre technologie sur laquelle travaille le laboratoire de la NHK concerne la télévision 3D. Ses
recherches visent en effet à créer des images 3D visibles sans lunettes et de n’importe quel angle. Le laboratoire travaille, par ailleurs, sur la mise au point d’écrans ultra-plat et
souples32. L’investissement de la NHK sur son laboratoire est constant. En 1977, la NHK consacrait 3% de son budget à la recherche avec un effectif dans son laboratoire de 500 chercheurs33.
Ce laboratoire aujourd’hui fonctionne avec seulement 250 chercheurs mais un budget de 18,2 milliards de yens, soit 2,6 % du budget total11. L’INTERNATIONAL NÉGLIGÉ La NHK a cependant son
talon d’Achille. Bien que dotée d’une chaîne de télévision internationale, NHK World, lancée en 2009, celle-ci reste sclérosée par l’esprit dans lequel elle a été créée. Le cahier des
charges fixé par la loi sur l’audiovisuel de 1950 précisait ainsi que la NHK devait s’efforcer d’être la vitrine internationale du pays. Mais alors que cet effort s’est concrétisé en France,
par exemple, par la mise en place d’une chaîne d’information en continu, France 24, NHK World diffuse plutôt des émissions culturelles vendant le _cool Japan_ au monde entier. Résultat :
lors de la catastrophe naturelle et nucléaire du 11 mars 2011, la diffusion d’informations permanentes par cette chaîne a révélé une improvisation et un certain amateurisme. La chaîne se mit
à diffuser des traductions simultanées de flashs d’informations de la chaîne nippone avec des difficultés apparentes. Un réel effort fut mis en œuvre pour informer mais celui-ci ne permit
pas de cacher ce qui apparaissait de manière béante à l’écran : un sous-investissement de la NHK sur sa chaîne internationale. Il se pourrait bien que CCTV News, la chaîne internationale
chinoise produisait au même moment des JT, au moins sur la forme, plus convaincants que sa concurrente nippone. DONNÉES CLÉS * DIRECTEUR-GÉNÉRAL : Shigeo Fukuchi. * BUDGET EN 2010 : 678,6
milliards de yens (soit près de 6 milliards d’euros). * EMPLOYÉS : 11 000. * DATE DE CRÉATION : 1925. RÉFÉRENCES * Philippe BERTHET, Jean-Claude REDONNET, _L’audiovisuel au Japon_, Que
sais-je, Paris, 1992. * Masami ITO (dir.), _Broadcasting in Japan. Case studies on Broadcasting systems,_ Routledge, Londres, 2011 (1ère éd. 1978). * Ellis S. KRAUSS et Susan J. PHARR,
_Media and Politics in Japan_, University of Hawai’I Press, Honolulu, 1996. * Ellis S. KRAUSS, _Broadcasting Politics in Japan. NHK and Television News_, Cornell University Press, Ithaca,
2000. * NHK Broadcasting Culture Research Institute, Broadcasting in Japan. _The Twentieth Century Journey from Radio to Multimedia, _NHK, Tokyo, 2002. * Takesto WATANABE, _“Japan’s media at
present”_, mars 1996. -- Crédits illustrations : CrucifixJEL.deviantart.com * 1NHK Public Relations Department, NHK Annual Report 2010/2011, avril 2011, p. 18. * 2Philippe Berthet,
Jean-Claude Redonnet, L’audiovisuel au Japon, Que sais-je, Paris, 1992, p. 7. * 3Broadcasting Culture Research Institute, Broadcasting in Japan. The Twentieth Century Journey from Radio to
Multimedia, NHK, Tokyo, 2002, p. 29. * 4Masami Ito (dir.), Broadcasting in Japan. Case studies on Broadcasting systems, Routledge, Londres, 2011 (1ère éd. 1978), p. 64-65 ; NHK Broadcasting
Culture Research Institute, op. cit., p. 5. * 5Ibid., p. 16 Cf. article Yomiuri InaGlobal. * 6Ibid., p. 31-32. * 7NHK Public Relations Department, op. cit., p. 5. * 8Masami Ito (dir.), op.
cit., p. 55. * 9NHK Public Relations Department, op. cit., p. 18. Taux de change au 12 mai 2011 (1 euro = 114,54 yens). * 10Philippe Mesmer, « Au Japon, la NHK vit avec les recettes de la
redevance », Le Monde, 30 janvier 2008. * 11a11b11cNHK Public Relations Department, op. cit., p. 18. * 12Philippe Mesmer, « Au Japon, la NHK vit avec les recettes de la redevance », Le
Monde, 30 janvier 2008. * 13HK Public Relations Department, op. cit., p. 18 ; A titre comparatif, sur la même période le chiffre d’affaires de France Télévisions s’établissait à 3,1
milliards d’euros. Cf. Paule Gonzales, « Les bon comptes 2010 de France Télévisions »<, Le Figaro, 28 avril 2011. * 14HK Public Relations Department, op. cit., p. 18 ; A titre comparatif,
sur la même période le chiffre d’affaires de France Télévisions s’établissait à 3,1 milliards d’euros. Cf. Paule Gonzales, « Les bon comptes 2010 de France Télévisions », Le Figaro, 28
avril 2011. * 15Masami Ito (dir.), op. cit., p. 31. * 16Ibid., p. 52. * 17Philippe Berthet, Jean-Claude Redonnet, L’audiovisuel au Japon, Que sais-je, Paris, 1992, p. 58. * 18Masami Ito
(dir.), op. cit., p. 35. * 19NHK Public Relations Department, op. cit., p. 04. * 20Signifie descente du ciel. * 21Takesato Watanabe, “Japan’s media at present”, mars 1996. * 22a22bAnthony
Faiola, « Scandals Force Out Japanese TV Chief », Washington Post, 26 janvier 2005. * 23Masami Ito (dir.), op. cit., p. 59. * 24NHK Broadcasting Culture Research Institute, op. cit., p.84. *
25Ibid., p.60. * 26Ibid., p.59. * 27Philippe Berthet, Jean-Claude Redonnet, op. cit., p.24. * 28Masami Ito (dir.), op. cit., p. 19-21. * 29Ibid., p.20. * 30Maxime Labat, « NTT et la NHK
effectuent un transfert d'une vidéo Super Hi-Vision sur un r&eac ute;seau partagé », Bulletins électroniques Japon, n°565, 25 février 2011. * 31« Le Japon au cœur de la télévision
de demain », La Croix, 4 juillet 2009. * 32NHK Public Relations Department, op. cit., p. 17. * 33Masami Ito (dir.), op. cit., p.73. QU’EST-CE QU’UN MÉDIA DE SERVICE PUBLIC ? - ÉPISODE 12/15
L’idée d’un service public de l’audiovisuel est ancienne au Japon. Créée en 1925 sur le modèle de la BBC, la NHK oscille entre proximité avec le pouvoir et démocratisation. Réputée pour la
qualité de ses programmes et l’innovation technologique, elle semble renouer avec ses démons.
